Amy Clampitt dans Rehauts
Lire une revue de poésie oblige à un temps particulier, à une concentration. Parfois, on se rend disponible et on accueille une voix, une langue qui, soudainement, s’impose.
Le numéro 42 de Rehauts, revue admirable qui a fêté il y a quelque temps son 20e anniversaire, propose des pistes, des chemins – on pense à la sinuosité à demi-effacée de celui de Gracq –, pour y découvrir quelque langage qui trouve un écho en soi, qu’il nous réplique ou nous perturbe.
Et l’ouverture de cette livraison est impressionnante, c’est le moins qu’on puisse dire ! Un long poème d’Amy Clampitt, poète états-unienne née en 1920 dans l’Iowa qui porte une livraison de facture soignée que ponctuent de très beaux dessins de Claude Briand-Picard et de Pierre Mabille. Je l’avoue d’emblée, je ne connaissais pas Clampitt dont le poème, exploration de l’état migraineux, déploie des éléments de l’existence qu’entrecroisent des lectures, des figures esthétiques, compagnons dans l’écriture. Et finalement d’une forme de douleur, tenace, continue. Il s’y constitue une communauté et un partage.
Aux côtés d’une élite
dans l’étau de la même couronne splénique :
Dorothy Wordsworth, George Eliot, Margaret
Fuller, Marx, Freud, Tolstoï, Chopin, Lewis
Carroll, Simone Weil, Virginia Woolf :
un assemblement de teintes,
d’ancêtres et de meilleurs amis qui avaient tous passé par cette dure école.
Son « Anatomie de la migraine » – traduit par Gaëlle Cogan et Calista McRae – est construit sur une dichotomie fondatrice qui se réplique tout du long de ses deux parties. À la fois réflexion sur la voix, son énonciation, l’élaboration de la parole poétique, et méta-poésie qui se cherche des miroirs, des compléments, le poème se tient remarquablement, équilibré et puissant. On y est tout à la fois du côté du saisissement, de l’éclat, et d’une véritable continuité narrative. Cette plongée dans le corps et l’esprit, comme entreprise par un même élan. Et c’est probablement cette concomitance de la description extraordinaire de la corporalité et d’une sorte d’aventure spirituelle et artistique qui frappe le lecteur. C’est dans le corps, par ses manifestations, que la vie intérieure devient possible, que l’intellect se déploie. La sensitivité, la matière et l’idée se reflètent ainsi d’une manière bouleversante. Car c’est sous « une couronne d’artères calottée », dans ce « creux peuplé de fissures, de déclivités, de buissonnements arborés, d’appariements et de degrés » que naissent la vie, l’idée, la morale, la conscience, « tout cela enfermé dans une coquille de noix ».
Amy Clampitt écrit, assurément, une grande poésie de la conscience. Difficile de construire un numéro après une ouverture si impressionnante. On trouvera, comme dans chaque numéro de Rehauts, des textes qui, par leur hétérogénéité, leur refus de l’école, leur diversité et de formes et de démarches, forment une sorte de tissu qu’il faut parcourir, comme un doigt passé sur des étoffes. On lira des poèmes de Fabienne Raphoz, de Franck Doyer, d’Henri Droguet, de Pierre Mabille, de Laurent Cennamo, de Maurice Benhamou et d’Yves Boudier. Deux proses s’y intercalent, signées de Mina Sürgen et Mathieu Nuss. Une sorte de panorama du dissemblable. Comment construire un numéro, donc ? En le faisant s’achever sur un texte consacré à Franck Venaille disparu à l’automne dernier, il fait comme une boucle, esquissant un reflet au poème d’Amy Clampitt. La lecture que propose Jacques Lèbre de Requiem de guerre (Mercure de France) revient sur une œuvre atypique, qui elle aussi cherche infiniment l’altérité. Comme en duel, on lira ces vers, qui pourraient répondre à l’Anatomie… :
Vous me frottez le crâne puis les tempes pour en chasser les démons et vous dites
simplement que la nuit sera longue et que je dois me recoucher paisiblement.
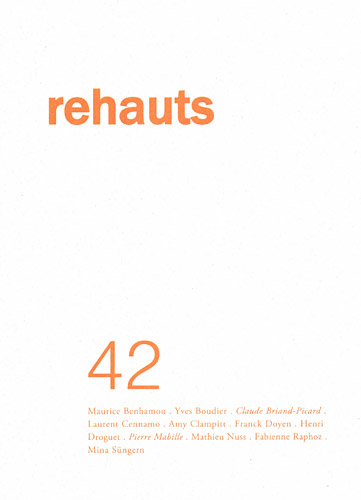
Retrouvez l'article sur entrevues.org
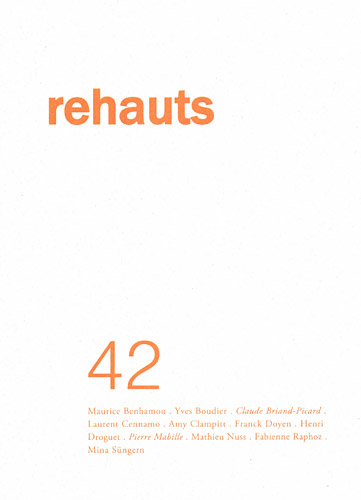
Chaque revue se distingue par l’organisation de son sommaire ; pour Rehauts, un numéro s’ouvre toujours avec une traduction, cette fois avec un long poème, "Une anatomie de la migraine" d’Amy Clampitt (1920-1994, poète des États-Unis dont aucun de la douzaine de livres, poésie et prose, qu’elle a publiés n’a encore été traduit en français. Le motif de la migraine charpente les 25 quatrains de la seconde partie, rappelant que bien des écrivains et penseurs en ont souffert, de George Eliot à Marx et Freud, de Chopin à Virginia Woolf, mais c’est la question de ce qu’est la conscience qui occupe les 25 premiers quatrains et, d’ailleurs, le mot "conscience" clôt le poème. Un tour rapide des positions, de Gallien à Descartes, pour s’arrêter à Simone Weil ; pour elle, la conscience, c’est « La douleur. / L’attraction de la pesanteur. Le martellement du temps. / Une misère qu’aucun système // ne peut racheter, affliction extrême qui /détruit le je : rien n’est pire, écrit-/ elle ». C’est alors le statut du je (« l’Un qui n’est pas un / du tout mais contradiction ») qui apparaît en filigrane, et c’est bien lui qui organise l’ensemble du poème.
Les voix retenues dans le reste de la revue, très variées, prouvent la diversité de la poésie de langue française : le lecteur aurait fort à faire pour construire des relations entre les textes publiés, et c’est tant mieux. La plupart d’entre eux sont de poètes "reconnus", qu’il s’agisse par exemple de Maurice Benhamou ou Yves Boudier, du peintre Pierre Mabille auteur, également en 2018, de C’est cadeau, et qui joint des dessins à des poèmes tous titrés de noms de couleurs ("Noir et blanc", "Bleu nuit", "Jaune", etc.). Ou de Fabienne Raphoz, qui a publié récemment Parce que l’oiseau, dont le poème plein d’ellipses aborde le motif de la métamorphose, du plaisir du classement des espèces, de l’origine (de la vie, des espèces). Ou de Henri Droguet, avec le plaisir de lire allitérations (« de guingois les guinguettes ») et assonances (« la bise drue / murmure brisure friture à lanterlus »), les deux mêlées (« l’hasard et l’azur »), des créations de mots (« « ça rache ») et l’emploi d’autres dits "familiers" (« foutoir, corbac, badigoinces »), et la vision humoristique d’un monde à côté du nôtre (« une fourmi cancéreuse meurt »), ce qui permet une distance vis-à-vis du lyrisme : l’escargot ne connaît pas l’amour, « qui est / l’autre nom du vertige »…
On s’arrêtera à la lecture d’un poète, Laurent Cennamo dont L’herbe rase, l’herbe haute a paru récemment (Bruno Doucey, 2018) après plusieurs livres chez des éditeurs de Genève. Les 26 strophes en vers libres de "L’inexistante fée" sont construites autour du thème de la mort proche (« La fenêtre est brisée qui nous séparait / du néant »), avec justement la récurrence du mot "mort" et la présence d’autres évoquant la destruction ou la fin de vie (« desséché », « déraciné », « Plus de sang », etc.), du thème aussi du passage, (« mourir, / Naissance », « Mourir, naître — sur la même / corde raide ») et celui de la métamorphose. Impossible de retrouver quoi que ce soit du temps passé, pas plus le temps de l’enfance que de celle qui désormais reste silencieuse dans le « panier du vide (au bras / de l’inexistante fée) ».
On lira aussi Franck Doyen, Mina Süngern et Mathieu Nuss, et la recension de Requiem de guerre, livre de Franck Venaille disparu le 23 août 2018, à qui cette livraison de Rehauts rend hommage. Jacques Lèbre y met en évidence chez le poète son sens de la révolte, sa manière de mêler sans cesse le vécu et la fiction, son humour et, d’un bout à l’autre de l’œuvre, sa tendresse pour ses semblables. Voilà des heures de belles lectures.
Retrouvez l'article sur sitaudis.fr (19 janvier 2019)
Convenablement programmée, alimentée par des données en masse suffisante, une machine peut produire des similis poèmes. Dira-t-on pour autant qu’il y a des robots poètes, comme il y a des robots joueurs d’échecs et de go ? Non. Un poète est apte, comme tout être humain, à faire des multiplicités d’autres choses que des poèmes. Et ces autres choses, telles qu’il les ressent, sont une des bases de son écriture. Le robot, d’une part est spécialisé dans un domaine bien défini, d’autre part, il ne ressent rien. Le temps que retombent les papillons, de Jean-Pierre Chevais, n’a rien à voir avec la robotique. L’ouvrage, composé de sept séquences de longueur inégale, précédées d’un avant-poème, fait largement part à l’intuition.
De quels papillons s’agit-il ? Pas de ceux, allant de fleur en fleur, dont le langage courant a fait le symbole de l’inconstance amoureuse. A rapprocher le titre du livre de sa page 27, les papillons sont clairement des mots, LES mots : « inger / christensen elle / quand la poussière / se lève un peu / elle dit que c’est / l’envol des pa / pillons du monde / moi quand je / souffle sur les mots / ça ne tient pas ça / bat des ailes / c’est bien la preuve ». Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Dans le poème préliminaire, les mots sont des légumes : « Maman a / vant elle / pelait les mots / une pelure par / mot ». C’est après la mort de la mère que « les papillons a / lors ont / commencé ». N’empêche que les mots ne sont pas toujours des papillons : « les mots ils / cognent / fendent cassent ». Parfois, c’est le poète qui, de ses bras, fait des ailes et s’envole, les mots ne suivent pas, il ne peut pas les abandonner, redescend.
L’indécision gouverne le rapport du poète à ses mots. Aux premières pages, il garde confiance : « sûr / je trouverai » écrit-il à la destinatrice de ses confidences, dont il cherche à écrire le nom. Un peu plus loin, il l’a perdu – comme, d’ailleurs, il avait déjà oublié le sien. Ne lui reste que l’initiale. Or, ce n’est pas uniquement un individu, une femme, qu’il faut nommer, ce sont les mots eux-mêmes, pour savoir ce qu’ils désignent. Faute de précision, le doute s’installe. Souvenons nous que Précis d’indécision est le titre d’un ouvrage antérieur de Jean-Pierre Chevais (cf. Les Lettres Françaises de septembre 2009).
Sauf erreur, c’est la première fois qu’un de ses livres pratique en son entier l’enjambement des vers par les mots, sans même un trait d’union. Rien que la respiration du lecteur. Outre Inger Christensen, d’autres écrivains sont nommés : Charles Ferdinand Ramuz, Carlos Levi, Mahmoud Darwich (c’est nous qui mettons des majuscules) ou évoqués par allusions. Le célèbre « je préférerais pas » introduit le personnage d’Herman Melville, qui, lui sait ce qu’il ne veut pas, c’est à dire tout : « je préférerais pas / qu’on m’ap / pelle bartle / by ». Ce serait en effet une erreur. Jean-Pierre Chevais accueille, essaie, par exemple, d’ajouter des herbes aux mots afin de leur donner un peu de poids.
Une seule lettre substituée à une autre et tout change, ainsi « à la longue » engendre « ça fait / drôle / à / la langue / ces mots / qui / parfois / remontent ». L’ironie est partout perceptible, elle est le voile pudique d’une désespérance qui en vient, aux dernières pages, à disloquer les vocables de manière imprononçable : « J’a / i pas les m /ots / on m / e dit / ça », « il est t / ard dé / jà j / e / tombe / avec la / dernière a / ile ». Rassurons-nous. Si l’auteur en peine déclare : « j’ / aurais pas / dû / faire / papillon », il n’y a aucun risque qu’il en déduise « j’aurais dû faire / robot ».

Retrouvez l'article sur Les Lettres françaises, n°156, page IX, "Chronique poésie" de Françoise Hàn (janvier 2018)

Qu’est-ce que perce-voir ? Longer, toucher ? Qu’est-ce qui traverse l’air sans yeux, sans indications de tempi sur la partition du sol, avant l’allée allée, avant le corps sans le pas, comme un crépi déshérité ?
Lieux, mouvements où voir dérange, perd à force de se croire contact. Comment y intégrer plus de bruits, moins de violoncelle ? Moins de gouleyant à vol d’hirondelles, et plus de cerveau reptilien ?
Frisson, corbeille à papier (…) : tout le poumon chaque jour de parole (…) perdue.A vivre, à alarmer, renier – double mental ; monologue a minima, à changements de trottoir dans la foule.
Ni réquisitoire, pourtant. Ni même fuite. Mais, austèrement, une table, un résidu même où se taire soit naturel, son pur, chance de passer aux aveux. De produire son propre effet de serre ! …
Souffle, errance : la quête entre toutes. Reflets, imitations – de quoi, au vrai ? Comme une seconde où les pinceaux s’emmêlent, sont mêmes et uns.
Aucun dépit, d’ailleurs. Aucune excuse. Une progression ( ?), une plongée sous elle – pour quel espace ? Monsieur Ricin à pas lourds, à signatures de stress, d’asphalte irrémédiable.
Comme – d’où, par dissolution : à quelle croisée vide, ou quel crible ?
La plupart des livres marchent à l’ombre : à l’ombre – notre contemporaine.
Cycles organiques dans le fumier, grisaille, et Schubert qui appose son voile fraternel sur ce qui environne
Sous quoi il n’y a pas d’être, pas de couche infinitive.
O pudique, arrosé Monsieur Ricin, sans égal pour faciliter (ou biffer, ou corroder) la constante montée des mots (ou maux, ou morts ?) ; pour happer le subtil (ou non), la rature, le grêlé jaune – son tu… sous le trafic, les étages, son sourire d’arpège gercé.
*
Errance sans pointillisme mesquin. Qu’on accompagne, presque précède… Loin – comment dire ?
Un gris de langue soudain.
Qui frôle, rend tout digne.
Retrouvez l'article dans Poezibao (25 novembre 2017)
Quel goût aurait le numéro 40 de Rehauts ? Celui du thé ? « Délicatesse de la cérémonie du thé/qui m’apaise », « Cette amertume que je bois/Se répand dans mon corps/Et je ne meurs pas » (Jean-Claude Caër au cœur du Japon des temples, cimetières, sanctuaires). Au-delà de l’amer, un goût de mort, de rien si obstinément cultivé qu’il en arrive à faire sourire : le grain dru (…breton) des courtes et moroses pensées de Jean-Pascal Dubost : « Rien est le plus bel avenir qui soit », « Soyons morts, et fiers de l’être ». Un goût de nostalgie, le goût du père disparu: « …et si mon poème/Qui voulait parler de mon père en cette ville d’Arras/Reconstruit quelque chose qui ressemble/A des moments de sourire dans l’imparfait de sa vie ? » Fluidité de James Sacré qui caresse les arbres d’Alexandre Hollan, croise les « petits ustensiles de cuisine en métal émaillé » et un trombone. Un goût de médicament qui fait rire, c’est sûr, concocté par Daniel Cabanis dans une série de tableaux (« Pharmacie chevaline ») ; en voici deux incipit « Oui, madame, le chapeau fait grossir. », « Non, Monsieur le surmoi ne s’opère pas, surtout gros comme le vôtre. »
Non, impossible de figer le goût de Rehauts – qui assurément n’a pas un gros surmoi mais un moi partagé, ouvert, infiniment plastique. Car on n’aura rien dit des notes acides de Christine Bonduelle (« 7 conversations courbes »), de l’entêtante mélopée de Christiane Verschambre (« dit la femme, ni l’enfant »), d’un puissant fumet Italien de Giuseppe Bonaviri et du nuage léger venu d’Allemagne (Karl Lubomirski).
Et puis ceci au cœur du numéro des œuvres de Patrice Pantin : dans un carré anthracite pas si certain, des lignes blanches se rencontrent, s’épousent, s’ignorent, se brisent. Des compositions à la beauté savamment simple qui donnent le goût de s’attarder. Rehauts en somme.
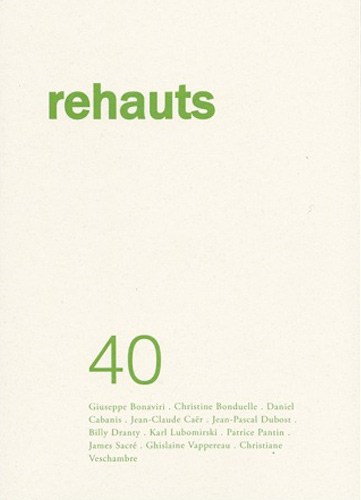
Retrouvez l'article sur Ent'revues

Le poème hérisson
AVEC MATHIEU NUSS, UNE PLONGEE DANS UN VRAI-FAUX JOURNAL OU S’ENCHAINENT DES PHRASES DONT LES MICRO-CATASTROPHES S’ELEVENT EN VERITABLE ART POETIQUE.
L’inversion du titre du film de Louis Lumière, projeté la première fois à La Ciotat en 1895, L’Arroseur arrosé, initialement intitulé Le jardinier et le petit espiègle, est le premier pied de nez du revigorant livre de Mathieu Nuss. D’emblée, comme le nez au milieu du visage, il annonce la couleur. Elle sera chapitrée « Monochrome du grutier » (II), « Vert bouteille » (III et IV) ou encore « Plateau peinture » (VI), mais pas que. Elle s’inscrit, ou se peinturlure, dans des phrases où la matière à réflexion (dans tous les sens) brille et accorde aux choses un coin de parution inédit, un voltage particulier de présence. C’est patent au début où le locuteur précise que si « la matinée ne cède pas un mot pour que je m’enfonce, semble-t-il, dans la lecture », c’est que « je chemine sur du goudron recoulé-daté-signé-noir ». Première nuance qui appellera toute une climatologie, que celle-ci affecte le sujet parlant ou toute extériorité venue à lui : « Façon d’œil cherchant une forme ou une idée, butant sur des angles mal rangés, sur la gravité qu’un pied de table n’absorbe pas ».
Le régime Nuss note des choses vues non depuis l’auto-réflexion intérieure, mais d’un point de renversement et de changement d’échelle : « Me suis transvasé dans un lieu puis, après décantation, une fois le trouble retombé (…) ». C’est que, entrecoupée par de mini-paragraphes où un art poétique se synthétise, Nuss fabrique des « segments intrus, contre sens et sécheresse extrême des tâches, flétrissures en unités toujours plus petites… », par quoi l’inflexion de la note ou du fragment, tels que les romantiques de Iéna en firent une forme-hérisson, se déploie autant en ironie qu’en rendant le sens versatile. Se cherchant, se fuyant, il se retourne contre lui-même. « Je laisse se faire et se défaire » est-il clairement écrit, mais le grutier du chapitre 2, du haut de sa cabine, déplie une phrase monochrome et éclaire la tâche : « Vidée de tout contenu, d’air même presque pressurisé, éblouissante d’habileté, la valise slalome, pareille à des phrases indemnes de tout contenu ». C’est que les « …poèmes optent pour / des résidences alternées, de / délicats autismes » dit l’un des sermons discrets du livre. Aussi Mathieu Nuss peut-il se demander « quelle proposition savante saurait rembobiner les détritus de la bande-son ? », pour plus loin « verser au dossier de la sale hygiène environnante : les plates-bandes d’herbes, de mauvaise qualité, dont l’image préfigure la déteinte au lavage, la couleur de l’anoxie, la luminosité d’une de ces ampoules basse consommation (…). La liste des déjections poursuit, dirait-on, toute seule son phrasé, « c’est le venteux définitif qu’il m’importe de rapporter, cette artère dans laquelle les pas déglingués, de + en +, puisent l’oxygène du dire sans complexe ni complaisance ».
Si l’on peut se sentir parfois abasourdi par la hardiesse de composition, son paysage y étant comme « trois types mains dans les poches se volent la visibilité », c’est qu’il faut se laisser aller au mouvement kaléidoscopique et à ses diffractions pour être soi-même saisi par la joie d’une langue si arrosée qu’elle torsade l’espace mental de l’arroseur : « la caméra tourne autour d’une carrosserie dégoulinante de pluie : voici le paysage, gris acier gris indépendantiste, noire caméra gonflée d’assurance ». C’est bien ça, une plongée dans « du noir indépendantiste », le risque de celle-ci pour ça continue à tresser une langue de raccords inouïs.
On ne lui en voudra pas d’opérer ainsi avec sa table de montage et de lancer, pyrotechnicien à la pointe, ceci encore : « débattre des diverses électrocutions diurnes », « des odeurs varappent », « l’irrémédiable asphalte, et pourquoi pas même à la rouille aux trousses », comme d’écrire ces « reflets d’aluminium déchirés dans les flaques » où Nuss y reconnaît que « faire de la poésie c’est mettre quelque chose dehors à sécher…». Peinture oblige.
Retrouvez l'article dans Le Matricule des Anges n° 185 (juillet-août 2017)
Perros, dans ses Papiers collés, notait : « Les poètes écrivent mal. C’est leur charme. Si tout le monde écrivait comme Anatole France, lire ne serait plus et définitivement qu’une entreprise maussade. Ils écrivent mal, n’ayant qu’un obstacle mais cet obstacle impossible à franchir. Ils le retrouvent partout. C’est le mot. »1 Le mot, les mots, c’est le matériau de la poésie de Jean-Pierre Chevais.
Le livre est divisé en six ensembles, et le premier est fondateur : un seul poème, qui s’ouvre par : « Maman a / vant elle / pelait les mots » ; si l’on pèle restent des pelures et, à travers les images des pelures utilisées comme bandages, je lis l’apprentissage de la langue, de la langue maternelle. La mère disparue, « les papillons a /lors ont / commencé » : vers sibyllins, comme l’est le titre, si l’on oublie que le papillon symbolise le changement ; dans l’usage, c’est la continuelle transformation des sens, non maîtrisable, et une absence de relation entre les mots et les choses : arbitraire analogue aux mouvements du papillon. Ou mots comme la poussière, ainsi chez Inger Christensen2,
quand la poussière
se lève un peu
elle dit que c’est
l’envol des pa
pillons du monde
moi quand je
souffle sur les mots
ça tient pas ça
bat des ailes
c’est bien la preuve
pas dur d’en at
trapper trois quatre
avant qu’ils ne re
tombent
Et il faut ajouter avec Mahmoud Darwich que « la trace du papillon / ça s’efface pas ».
Les mots sont bien un « obstacle impossible » et, en même temps, la condition pour la poésie de dire ce qui échappe au sens. Il est loisible de passer d’un mot à un autre, par exemple par l’étymologie ou par les jeux de ressemblance. Le nom de Ramuz évoque-t-il par le latin la branche, alors peut-on dire « Ramuz c’est /un endroit feuillu / ça fait drôle de / le voir avec / des feuilles autour / des feuilles avec / dessus des mots » ; le nom la Lucania venu de Carlo Levi (dans Le Christ s’est arrêté à Eboli), entraîne le mot "lucane", sans qu’il y ait dans la réalité un rapport quelconque entre le lieu et l’insecte. Voilà bien une leçon, « Les mots il faut / pas trop mettre / les doigts dessus », leçon que le poète ne suit évidemment pas.
Un mot en appelle un autre et l’on peut aussi remonter dans le temps pour prendre en compte les mouvements de la langue ; est ainsi recopiée et datée la première forme de dégringoler, "desgringueler, 1595", ce qui suscite « je dévale (…) la gringole », jeu avec l’étymologie, puisque dé- indique bien dans le verbe le point de départ. Les liaisons qui s’établissent entre les mots sont complexes, d’autant plus que dans certains cas « il ne se passe rien » ; par ailleurs, la langue de l’écriture n’est plus aisément lue dans la mesure où, affirme le je, « j’/ écris dans / une langue / mi / morte ». L’affirmation paraît paradoxale, le vocabulaire employé appartenant, comme on dit, à un registre courant, et les constructions grammaticales mimant parfois ce que l’on attribue à l’oral, avec par exemple l’élision du ne de la négation (« ils aiment pas ») ou l’usage répété de ça. Mais les mots « fendent cassent » et les vers (rarement plus de trois syllabes) se déglinguent, jusqu’à ne pouvoir être articulés :
Je préfèrerais pas
tout
compte fait sur
vivre à
mon c
orps il est d
ans un é
tat
on me dit ç
a
(…)
On (sans que l’on sache qui est ce "on") reproche par ailleurs au je ces vers trop courts, ce qui accuse démesurément la part du blanc dans la page ; la réponse introduit un autre aspect du livre, l’humour : « ça je sais / je n’ / arrive / pas ». Lorsque viennent dans un poème « bethsabée au bain » et « diane au bain », ce sont moins les allusions mythologiques qui importent que la possibilité, ensuite, d’écrire « tout tombe à l’eau » et de signaler que tout part « à vau-l’eau ». Jeu avec la culture, certes encore quand, dans une série de poèmes s’ouvrant par « Je préfèrerais pas », l’un d’entre eux se poursuit par « qu’on m’ap / pelle bartle /by » : il faut alors se souvenir du personnage de Melville et de son "I would prefer not to".
Mais les allusions culturelles, si elles ont pour fonction de lier le poème à l’histoire, appartiennent surtout, me semble-t-il, au vaste réseau d’associations dont font partie les mots de la langue et qui ne peut être épuisé. Mots de la langue qui sont ancrés dans le temps, et de même les noms de personne : écrire des noms comme "Béatrice" ou "Bérénice", c’est encore évoquer des livres, c’est-à-dire des relations dans l’Histoire. L’épaisseur du temps rend difficile l’appréhension de ce que chacun a vécu, et s’il est malaisé d’écrire le rapport à l’autre — le je renonce à dire ce qu’est le vous —, il l’est tout autant de dire quoi que ce soit de soi, ce qu’exprime ici la perte du nom : le mot lui même disparaît dans son unité (« mon n / om ».
On n’a fait que parcourir ce livre qui avance avec ses papillons en faisant comme si l’essentiel était de jouer avec les mots (la grammaire, le vocabulaire, les associations), avec le vers, avec le temps. On pourrait lire autrement, se préoccuper de la très forte composition de l’ensemble et de son contenu ; un aperçu : au premier poème isolé succède une séquence de 19 poèmes, puis de 5 commençant tous par « Je préfèrerais pas », ensuite on lit un ensemble identique pour la forme, en miroir, donc : 19 + 5 + 1. On découvre aussi dans un poème le père — mais ce n’est pas lui qui transmet la langue… Un livre réjouissant et qui donne à penser à ce qu’est notre relation aux mots, à l’autre.
1 Georges Perros, Papiers collés, Le Chemin/Gallimard, 1960, p. 80-81.
2 Jean-Pierre Chevais a édité Inger Christensen (Herbe, Atelier La Feugraie, 1993).

Retrouvez l'article sur sitaudis.fr
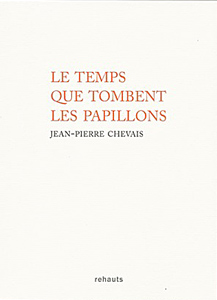
Rares les poètes qui savent rendre compte d’une conflictualité avec les mots ; comme s’ils devaient toujours, les mots, manquer la cible qu’ils visent ? C’est l’impression que donne Le temps que tombent les papillons, à la limite du bégaiement, au bord de l’asphyxie :
on
risque de s’
essouffler
an
hélation
suf
focation
Pas d’autre objet, ici, que cette inadéquation des mots aux choses, à la vie, et tout aussi bien à une quelconque identité. En lisant ce nouveau recueil de Jean-Pierre Chevais, on pourrait penser aux pierres d’un mur qui se descellent assez pour lui faire perdre sa certitude de mur ; à du plâtre qui s’effrite, ou bien au plâtre dans les fresques de la Renaissance dans la mesure où il est une partie désormais muette dans la trame colorée autant que dans l’histoire racontée. Ce recueil dit le désir acharné d’une parole et l’effritement concomitant de cette même parole. C’est là que ça oscille :
J’a
i pas les m
ots ç
a ira
pas on m
e dit
ça
j’a
i pas les b
ons que
des u
sés des t
rop u
sés on m
e dit
ça
je v
ais le dire
aux m
ots
Souvent mot et vers se confondent, entre flux et reflux, coups de boutoir contre la falaise blanche de la page.
Cette conflictualité avec les mots était déjà sensible dans les recueils précédents de Jean-Pierre Chevais. Dans Le livre des figures (Atelier la feugraie, 1993) : « Qui saura du bout / desdoigts dire / le mot / droit / qui vous relève la tête, / fût-elle de cendre mouillée / -- qui ? ». Dans Moments venus (Atelier la feugraie, 1998), c’était le souffle qui semblait s’épuiser entre les vocables ou bien dans les marges : « parfois sur la feuille / pourtant où / le poème s’écrit / j’entends comme une haleine perdue / traverser marge et blancs. » Et nous pouvions lire encore : « je perds pied, / biffe les mots », et tout aussi bien : « Je ne sais plus je crois / que tout est à recommencer. » Dans Seuils (Folle avoine, 1998), les mots semblaient ourdir on ne sait quoi, plus loin, en dehors de soi : « il y a / à peine plus loin que soi / des mots qui s’absentent d’euxmêmes / qui se retournent qui chuchotent / de dos ». Pas facile de les attraper les mots, de les retenir ; parfois semblables à des papillons, on croit qu’ils s’approchent alors qu’ils s’éloignent. Dans Précis d’indécision (Atelier la feugraie, 2007), nous pouvions encore lire ceci : « Ah vous écrivez […] Et c’est quel genre ah oui plutôt dans ce genre-là ah oui dans ce genre-là aussi ah vous hésitez et c’est depuis toujours mais vous avez commencé tôt ah quand même vous vous êtes arrêté ah pas plus et lorsque vous avez repris ah toujours pas ça n’a pas dû être facile. » Et plus loin : « suffit de croire qu’en disant je on pourrait recoller les morceaux colmater les fissures ou combler les trous – le désastre est le même au début au milieu à la fin les lignes de vie restent des lignes de faille à quand l’effondrement des sols. » Dans Quatre figures (une plaquette à La Rivière échappée), c’est encore ceci que nous pouvions lire : « le temps est venu / d’ici vivre / hors de la consolation / et cette gorge / ma gorge en feu à hurler l’incomplétude ».
Dans Le temps que tombent les papillons, comme dans les recueils précédents, on ne peut qu’être retenu par la pratique de l’enjambement. Car cette pratique n’a rien d’elliptique. L’enjambement, chez Jean-Pierre Chevais, signale simplement que l’on vient, dans un élan, de passer d’un bord à l’autre d’une faille. Car c’est le propre de sa poésie que de nous rendre les failles sensibles, jusqu’au sein même du langage.
Retrouvez l'article dans la revue europe (n°1057-mai 2017)
Connaissez-vous David Constantine ? Poète et nouvelliste, né en 1944, il est aussi traducteur de Hölderlin, Kleist, Brecht, de Michaux et Jaccottet ; on a pu lire en 1992 Sorlingues (La Dogana) dans une belle traduction de Yves Bichet et quelques poèmes, dans la revue en ligne Recours au poème grâce à Delia Morris et André Ughetto. Rien d’autre alors que l’œuvre compte plus d’une dizaine de titres. Rehauts, qui propose toujours en ouverture une traduction, en donne 12 poèmes, traduits par Perrine Chambon et Arnaud Baignot : c’est un choix varié qui va de l’observation d’un nuage et de rêverie devant une photographie au thème de la fenêtre miroir.
Des peintures de Stéphanie Ferrat, dont on connaît par ailleurs les livres poèmes, accompagnent un long poème de Caroline Sagot Duvauroux, "au commencement longtemps déjà" ; on y retrouve, pour le dire vite, ce qu’elle poursuit depuis ses premiers écrits : questionner l’ordre de la langue dans ce qu’il a d’indécidable, d’ambigu et, en même temps, faire que la vie, le visible, soient toujours présents dans l’écriture, jamais comme représentation — on se souvient qu’elle écrivait que « Si la vision était lisible on cesserait d'écrire. » * :
Un lac vert dans les yeux d’un homme. Deux
barques s’y croisent. Sur l’une, deux meurent de
honte. Sur l’autre, un peuple meurt d’espoir. Un
détroit de silence.
Le numéro publie également des poèmes d’Étienne Faure ; on y reconnaît le ton mélancolique qui affleure dans plusieurs de ses recueils, mais ici sur un motif nouveau : le narrateur se souvient d’un amour perdu. Remémoration du temps passé, de la lecture commune de Trakl, solitude de la vie présente comme dans ce début du premier poème :
Je dors dans un caisson nommé chambre,
suis là-dedans
et meurs tous les jours sous le sceau du secret
puis vais en ville essaimer des paroles,
amorcer la joie toujours après la peine (…)
On voudrait citer encore, au hasard dans ce riche numéro, Max de Carvalho ou les alexandrins rimés de William Cliff, qui poursuit l’exploration de son enfance, les poèmes de Stéphane Korvin et ceux de Bruno Grégoire, les souvenirs de Jacques Josse. On lira aussi les notes de lecture de Jacques Lèbre ; la première est consacrée au très beau livre d’Antoine Emaz, Limite (Tarabuste, 2016) la seconde permet de découvrir le poète danois Soren Ulrik Thomsen, traduit par Pierre Grouix (Les arbres ne rêvent sans doute pas de moi, Cheyne, 2016).
* dans Le livre d’El, d’où (Corti, 2012).

Retrouvez l'article sur sitaudis.fr
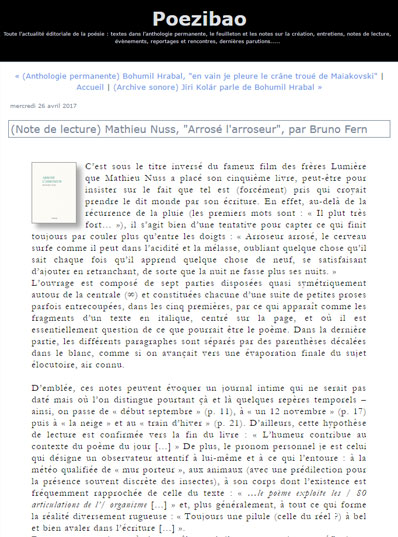
C’est sous le titre inversé du fameux film des frères Lumière que Mathieu Nuss a placé son cinquième livre, peut-être pour insister sur le fait que tel est (forcément) pris qui croyait prendre le dit monde par son écriture. En effet, au-delà de la récurrence de la pluie (les premiers mots sont : « Il plut très fort… »), il s’agit bien d’une tentative pour capter ce qui finit toujours par couler plus qu’entre les doigts : « Arroseur arrosé, le cerveau surfe comme il peut dans l’acidité et la mélasse, oubliant quelque chose qu’il sait chaque fois qu’il apprend quelque chose de neuf, se satisfaisant d’ajouter en retranchant, de sorte que la nuit ne fasse plus ses nuits. »
L’ouvrage est composé de sept parties disposées quasi symétriquement autour de la centrale (∞) et constituées chacune d’une suite de petites proses parfois entrecoupées, dans les cinq premières, par ce qui apparaît comme les fragments d’un texte en italique, centré sur la page, et où il est essentiellement question de ce que pourrait être le poème. Dans la dernière partie, les différents paragraphes sont séparés par des parenthèses décalées dans le blanc, comme si on avançait vers une évaporation finale du sujet élocutoire, air connu.
D’emblée, ces notes peuvent évoquer un journal intime qui ne serait pas daté mais où l’on distingue pourtant çà et là quelques repères temporels – ainsi, on passe de « début septembre » (p. 11), à « un 12 novembre » (p. 17) puis à « la neige » et au « train d’hiver » (p. 21). D’ailleurs, cette hypothèse de lecture est confirmée vers la fin du livre : « L’humeur contribue au contexte du poème du jour […] » De plus, le pronom personnel je est celui qui désigne un observateur attentif à lui-même et à ce qui l’entoure : à la météo qualifiée de « mur porteur », aux animaux (avec une prédilection pour la présence souvent discrète des insectes), à son corps dont l’existence est fréquemment rapprochée de celle du texte : « …le poème exploite les / 80 articulations de l’/ organisme […] » et, plus généralement, à tout ce qui forme la réalité diversement rugueuse : « Toujours une pilule (celle du réel ?) à bel et bien avaler dans l’écriture […] ».
Dans ces annotations où s’entremêlent subtilement sensations et réflexions, des thématiques dominent. Parmi elles, celle du voyage dont les qualités sont exposées avec lucidité : « Voyager c’est autoriser d’autres lumières à l’ennui, suivre comme moucherons les orages. C’est aussi s’évertuer à faire du poème un produit anti-âge. » ; celle aussi de la musique, à travers l’insertion de nombreux termes techniques (dont certains sont malicieusement détournés : « fiasco continuo »), l’évocation régulière d’instruments (clarinette, flûte, violoncelle, piano) et de compositeurs (Schubert, Liszt) puisque « …le poème veut s’ / inspirer de toutes les indi- / cations de tempi déchif- / frables sur la partition / du sol, avant même l’allée / allée, désherbée… » ; par ailleurs, les références picturales ne manquent pas, en particulier tout ce qui touche aux couleurs – l’une des parties est intitulée PLATEAU – PEINTURE, deux portent le même titre, VERT BOUTEILLE, et une autre celui de MONOCHROME DU GRUTIER.
Au(x) passage(s), Mathieu Nuss précise ses choix d’écrivain, notamment en commentant la démarche qu’il a adoptée ici : « Des influx plutôt que des lignes, planes ou courbes, ces fragments, entassés au petit bonheur, qui essaient tout autant de cacher, côte à côte, leur intime attache fusionnelle, que leur relation dominant-dominé, tantôt prédateur, tantôt proie étourdie, somnolente, puis avalée. » – extrait où il est évidemment fait écho au titre du livre. Enfin, il souligne l’importance existentielle de l’écriture pour lui : « […] tresser un cordage faussement résistant, car il s’agit de tresser quelque chose qui abrite plus sérieusement. » – et qui soit donc à lire ad libitum
Retrouvez l'article sur poezibao.typepad.com
« Le problème c’est la bouche. Mais enfin, nous pouvons toujours essayer » : David Constantine dont une série de poèmes ouvre splendidement le numéro 39 de Rehauts. Le problème c’est la bouche : les poètes de Rehauts s’y essaient et comment ! Max de Carvalho (« le mot ne te viendra/ que lorsque sans un/mot tu le reconnaîtras »), Bruno Grégoire (« Poète, sache faire danser/ta complexité/ou alors tais-toi, mais/sans en faire toute une histoire), en réponse les histoires d’appartement d’Étienne Faure (Allein, serait-on moins seul en allemand/ au motif que deux l, deux syllabes/ sont plus vivables pour résonner, établir avec l’écho qui s’installe entre elles/ dialogue et peut-être engouement au lieu d’un sec bonjour à l’adresse du mur […] ».
« le peu d’importance de nos êtres là » (Stéphane Korvin) cependant que des bouches s’y essaient : celle de Caroline Sagot Duvauroux en dialogue avec les peintures de Stéphanie Ferrat, celle de Jacques Josse pour dire un premier deuil (une grand-mère mais plus encore la mère du père), pour restaurer, avec la faconde de William Cliff et depuis la mémoire d’enfance, le corps pitoyable, attachant d’Ernest Gayolle, corps disparu : « […] nous sommes d’étranges virtuoses/qu’on viendra chercher au fond de nos fosses closes/afin de renaître à un glorieux Rehaut ». Glorieux Rehauts !
Et ceci encore, David Constantine : « je ne peux rien te dire de la mer et des îles. » Nous pouvons toujours essayer.
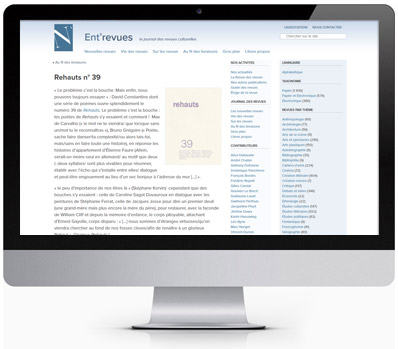
Retrouvez l'article sur entrevues.org

Comme le temps passe vite : Rehauts, la revue d’Hélène Durdilly, fêtera bientôt ses 20 ans. Ce sera en 2018. D’ici là, feuilletons la 38e livraison de cette revue, d’une élégante sobriété toujours, à la croisée de l’art (le titre même, rappelons-le, renvoie à la pratique du dessin) et de la littérature. Il y a de bien belles pages dans ce dernier numéro et ce sont surtout des poèmes. Et d’abord ceux d’Umberto Saba (1883-1957), des inédits traduits par Thierry Gillybœuf. Souvent l’Italien convoque des souvenirs et il a une façon bien à lui, dénuée d’effets, de passer de la ferveur à la nostalgie. S’y entend la voluptueuse tristesse d’un cœur simple – rendant compte, dans une note de lecture, d’une récente anthologie des poèmes de Jean-Pierre Lemaire, Jacques Lèbre rapprochera d’ailleurs celui-ci de Saba : « il y a, dans cette poésie, une discrète force, de persuasion ou de conviction intime ». Intériorisant l’étrangeté du dehors, croisant le merveilleux et le naturel, une dizaine de sonnets de Robert Marteau (1925-2011), là encore inédits, ne sont pas moins touchants. Son regard, chaque fois, sur le monde autour de soi, a l’air d’exprimer une sorte de gratitude familière teintée de mélancolie douce. La plupart des autres contributions sont des textes assez inclassables, et plus ou moins convaincants, tenant qui du journal (Marie-Hélène Archambeaud), qui du fragment (Vianney Lacombe), qui du monologue (Catherine Benhamou). Signalons, parce qu’ils sont désopilants, les passe-temps suicidaires (vous verrez pourquoi) de Daniel Cabanis ou l’évocation, par Paul Louis Rossi, des « voyageurs qui se sont aventurés dès 1245 au-delà des marches européennes, vers les steppes, les plateaux asiatiques et les montagnes de l’Asie, de la Mongolie et du Tibet ». Pour sa partie plus artistique, la revue présente les créations de Philippe Richard et Philippe Compagnon. Si différents qu’ils soient, leurs travaux respectifs semblent vouloir questionner le thème de la répétition ; chez l’un une peinture reprenant, plus ou moins mouvant, un même motif pour occuper l’espace, chez l’autre des variations, sur le mode sériel et graphique, de ronds et de lignes. Et enfin un troisième Philippe, Boutibonnes, habitué des lieux, qui n’en finit pas de questionner le dessin, son périmètre et son intelligibilité.
Retrouvez l'article sur entrevues.org
Thierry Gillibeuf, traducteur de poètes américains (comme Cummings, Marianne Moore) et d’écrivains italiens (comme Italo Svevo, Salvatore Quasimodo), propose quelques inédits d’Umberto Saba que le poète n’avait pas retenus dans son opus majeur, Il Canzoniere. Dans ces "Chansonnettes pisanes", presque toutes dans la forme du quintil, Saba est dans le monde, contre la guerre ou, sans ambiguïté, affirme son rejet de la religion :
Tandis que chantait l’alouette et que
le village était plein, ma vie tout entière,
de choses bonnes et heureuses ;
le plus ancien mensonge, le plus noir
est passé : en plein midi, un prêtre.
Il observe les faits et choses de la vie quotidienne ou se remémore les jours de l’enfance, le temps de la formation. À lire ces quelques pages — 15 poèmes — on regrette que le poète de Trieste ne soit pas plus traduit en français.
Paul Louis Rossi, dont on connaît le plaisir qu’il a à explorer des civilisations anciennes — on pense à La porteuse d’eau de Laguna ou aux Chemins de Radegonde — propose cette fois de suivre, avec des digressions, des expéditions depuis le XIII ème siècle en direction des Mongols. On sourit ensuite avec des textes courts sur des moyens originaux de se suicider, par exemple par balle perdue ou par auto-lapidation. On retient encore les extraits d’une pièce (Hors jeu) de Catherine Benhamou : au lecteur d’imaginer les voix et le jeu. Une suite de sonnets irréguliers de Robert Marteau (mort en 2011) rappelle que ce poète trop peu lu a publié plusieurs volumes de sonnets chez Champ Vallon ; il écrivait souvent à propos de choses vues qui, toujours, conduisent vers un ailleurs : « Un pas de plus / Et c’est un autre pays sous d’autres nuages. » Philippe Boutibonnes donne avec Disegno des « considérations sur le dessin » faussement simples : il est cependant nécessaire de les lire et relire pour comprendre, par exemple, qu’autrefois « le dessin faisait partie d’un rituel augural semi-magique (art pariétal). »
Une livraison de Rehauts contient toujours des illustrations, ici des dessins de Philippe Richard et de Philippe Compagnon. Elle s’achève, ou plutôt s’ouvre, sur des lectures, celles cette fois de Jacques Lèbre, analyses rigoureuses d’une recueil de Jean-Claude Caër, Alaska, et d’un choix de poésies de Jean-Pierre Lemaire fait par lui-même.

Retrouvez l'article sur sitaudis.fr

Après un relevé des emplois du mot ’’erre’’ (« mot que j’aime bien »), le livre s’achève sur « Erres : titre pour un recueil de notes ? ». À quelques exceptions près, Antoine Emaz choisit un seul mot pour titrer ses recueils de poèmes ou, comme celui-ci, de notes. ’’Planche’’, en dehors de la mise à plat, évoque le lien — du navire au quai —, et tout autant ce qui sauve (sens ancien de ’’planche’’ repris par ’’planche de salut’’). Ces sens conviennent pour approcher ce livre qui écarte, d’une certaine manière, un « blocage », celui de l’écriture de poèmes. Le poème ne s’écrit pas quand on le voudrait ; quand il survient c’est « comme si la vie / la langue étaient poreuses, porteuses l’une et l’autre d’une vérité simple. »
Il est beaucoup question de poésie dans Planche. D’abord parce qu’Antoine Emaz lit ses contemporains et commente plus ou moins longuement la manière dont il reçoit Jacques Ancet, James Sacré, Mary-Laure Zoss, Valérie Rouzeau, Ariane Dreyfus, Jean-Pascal Dubost, Jacques Josse, Nicolas Pesquès, etc. (on pourrait établir une chronologie des notes à partir des dates des recueils lus). Une place particulière est réservée à Jaccottet, à propos de son anthologie L’encre serait de l’ombre ; la qualité de la langue est reconnue, mais regrettée l’absence de tout nom de poète né après 1930, comme si la poésie avait alors cessé d’exister. Surtout, est vivement rejetée sa « morale de l’irresponsabilité » à laquelle est opposée celle de Camus : il ne faut jamais cesser de lutter — de se tenir debout, écrit Emaz —, or Jaccottet « semble ne rien voir des forces collectives en lutte pour écrire telle ou telle histoire ». C’est que l’écrit n’est pas à l’écart de la vie, de l’histoire.
Pour Emaz, le poème est toujours liée au vécu, à une circonstance biographique ou historique ; non qu’il pourrait être représentation de la vie, mais parce que doit être restituée « la densité humaine d’une expérience de vie » (le mot « expérience » revient souvent dans ces notes), c’est-à-dire ce qui donne du sens. Pour cela, il est nécessaire de bousculer la langue : ce n’est jamais l’émotion qui prime, il faut ajuster, retrancher, raboter pour ne pas rester dans l’immédiat. Dans une note, Emaz fait un éloge de la lenteur : c’est le « temps de l’usure et du renouvellement nécessaires pour laisser advenir en soi l’imprévu, le nouveau, sans forcément violence et rupture, plutôt évolution, maturation jusqu’à ce que s’impose ce qui doit être. » Ce primat du sens, de l’humain a pour corollaire le rejet du formalisme contemporain, la langue n’est pas neutre et écrire un poème ne consiste pas à « s’amuser avec un logiciel ». C’est toujours la vie vivante qui devrait primer dans la poésie (que l’on se reporte aux noms retenus ci-dessus), sans pour autant qu’un des thèmes de prédilection du lyrisme, l’amour, soit présent chez Emaz et il s’en explique : « Sauf au début et à la fin peut-être, aimer quelqu’un est bien trop compliqué pour que ça puisse entrer dans un poème. »
Antoine Emaz revient à plusieurs endroits sur la différence entre la note et le journal — lisant d’ailleurs le journal de Pierre Bergounioux publié sous le titre Carnet de notes… Pour lui, la datation tout comme la présence du sujet caractériserait le journal, alors que la note, « plus élastique », ne serait pas liée au quotidien. Genre attrape tout : il n’y a pas en effet que des remarques à propos de la poésie, des livres lus ou écrits ; on trouve un paragraphe sur le changement d’une nappe, sur le rangement de la bibliothèque, sur l’enfance et le jardin selon les saisons, on lit un titre possible (« ce qui ne se tait pas »), etc. La distinction entre journal et note tiendrait peut-être dans le fait que « la note doit valoir assez en soi mais elle tient aussi par les autres. »
Antoine Emaz publie aussi bien des ensembles de notes que des recueils de poèmes, poursuivant ainsi une longue tradition, de Baudelaire à Reverdy et du Bouchet pour retenir les écrivains auxquels il renvoie. On entre ainsi dans l’atelier où s’écrivent dans le désordre du carnet quelques lignes sur le rythme, puis quelques mots à propos de Gracq ; un portrait se construit, d’un homme ferme dans ses convictions et toujours dans la questionnement parce que sa poésie « opère le plus souvent dans le dur à vivre. »
Retrouvez l'article sur sitaudis.fr
Rehauts se termine toujours par « Lectures », chronique souvent tenue par Jacques Lèbre ; il y restitue ici la place particulière qu’occupe Robert Marteau (1925-2011) dans la poésie. Son œuvre repose sur « l’étonnement, la stupéfaction, l’émerveillement et le constat d’un non-savoir », ses sonnets sont « mémoire (d’Homère, d’Aristote, de Verlaine, d’André Chénier ou du tao...) sans quoi il n’y aurait ni vision ni écoute ». La revue s’ouvre toujours aussi sur une traduction, ici de l’allemand par M. Jacob et A. Villani (par ailleurs traducteurs de Peter Huchel), avec Erich Arendt (1903-1984) ; à lire les quelques poèmes offerts ici (dont un hommage à Marina Tsvétaïéva) on comprend mal qu’aucun de ses recueils ne soit disponible en français. Dans ce numéro illustré par les Ramures et diurnales de Gérard Titus-Carmel et d’extraits de Dessin bleu de Dominique De Beir, on lira aussi quelques aventures étranges d’un nommé Cook contées par Marie Étienne, des poèmes en prose ou en vers, de Camille Loivier, Ariane Dreyfus, Aude Chartier Vallart, Daniel Pozner, Jean-Patrice Courtois et Maurice Benhamou.

Retrouvez l'article sur cahiercritiquedepoésie.fr
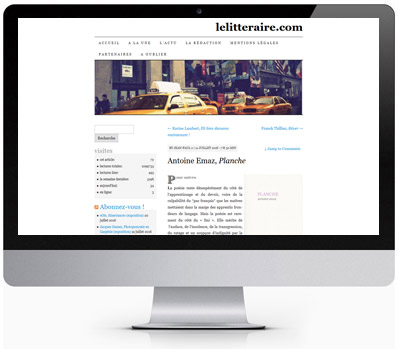
La poésie reste désespérément du côté de l’apprentissage et du devoir, voire de la culpabilité du “pas français” que les maîtres mettaient dans la marge des apprentis frondeurs de langage. Mais la poésie est rarement du côté du « fini ». Elle mérite de l’audace, de l’insolence, de la transgression, du ratage et un soupçon d’indignité par la parole.
Aux Planches de Froger capables de créer des tables ou des cercueils (POL, 2016, http://www.lelitteraire.com/?p=23335 ) fait écho celle d’Emaz. Les deux poètes sont maîtres en matériaux élémentaires choisis pour leur dualité interne et leur complexité que les métaphysiciens du langage ignorent et dont les activités spiritualisantes sont parfois infantilisantes. A leur opposé, Planche se veut une suite de notes écrites les jours « sans ». D’où leur intérêt. La poésie n’est jamais aussi pertinente dans la « creuxation », que dans l’érection. D’autant qu’Emaz, au gueuloir, préfère les zones de sous-tension où la vie fait ce qu’elle peut pour être. Ce qui, a n’en pas douter, est quelque peu sécurisant.
Il faut en effet à l’écriture un certain mutisme. Emaz nous l’a appris jusque dans sa « caisse claire » aux rumeurs assourdies. L’âge venant, le poète apprend à vieillir et son œuvre fait de même — mais comme un bon vin. Les esprits chagrins diront qu’Emaz a toujours été vieux : mais c’est ce qui fait son charme beckettien. Au miracle des aventures, il préfère le rouler boulant des circonstances quotidiennes.
Le texte se fait plus codicille (avec ses références) qu’évangile selon Antoine. Et c’est pourquoi le texte sent la fleur des champs (fût-elle fanée) que le formol formalisme et fort barbant (d’un Jaccottet par exemple). Poète de la feinte mollesse, Emaz reste celui dont l’humour est le vecteur redresseur (tant que faire se peut) de la désillusion.
En ce sens, l’auteur reste moins le « suicidé de la société » que son compagnon d’ « arrière-garde qui sonne l’olifant ». Emaz fait ce qu’il peut (voire bien plus) : d’où l’intérêt de son œuvre. Elle reste garante du peu qu’on est. Et pendant qu’il est encore temps.
D’où sa reprise en biais de Shakespeare : « Beaucoup de vie pour rien. C’est l’entassement de ces riens qui finit par faire une existence ». Le bruit de cet entassement crée une forme de confiance lucide à l’existence. On se serait satisfait de moins.
Retrouvez l'article sur lelitteraire.com
Les notes de Planche sont écrites durant des « jours, mois, muets » (p.60). Elles débutent par une question sans réponse : « Quelque chose que je ne vois pas bloque, déplace les masses internes, coupe les forces, obstrue. Quoi ? » (p.7). Il y a bien, face à « la nuit restante », une tentative de « déplier » quelques mots (p.27). Mais ce qui « bouge » ne concerne que la langue et manque l'« expérience de vivre ». Cette exigence de « l'écrire-vivre » s'accorde au contraire, selon une tension de langue moins forte, aux notes. Le mutisme du poème est alors décrit « sans drame », comme un fait (« les mots ne prennent pas la pente, voilà tout. », p.24), une circonstance de la vie qui « continue d'aller » (p.7).
Ainsi, comme dans Flaques, la note « ratisse […] large » (p.62). On passe d'un point sur le rapport vers-prose (p.18) à un « bon moment » face au jardin (p.54), d'une « vidange » de la bibliothèque (p.83) à vieillir (p.47), d'une réflexion sur le souvenir (p.101) aux lectures, véritables nécessités heureuses (« J'aime bien me sentir dans la circulation des œuvres des autres. Sans cela, j'aurais sans doute l'impression d'être formolé dans un bocal. », p.95). De fait, la lecture des Carnets de Bergounioux et de Life de K. Richards accompagne l'écriture de Planche. S'ajoutent les nombreux livres de poètes contemporains (Dubost, Vinau, Sautou, Ascal, etc.) et les revues, qui participent à l'ancrage dans le quotidien et le temps présent. Antoine Emaz s'oppose ici à Jaccottet, « retranché en lui, avec quelques pairs et des statues de sa stature » (p.40).
Ce choix du présent vient d'une préoccupation insistante : « La question qui reste, aujourd'hui, me semble être : qu'est-ce qu'on peut encore sauver, lucidement, de la désillusion ? » (p.61). Une réponse tient dans l'obstination de la poésie (« Chanter. Le peu possible. A bouche fermée, si nécessaire. », p.46). Elle incarne, pauvrement, le choix d'une « résistance durable plutôt que d'une lutte sans doute glorieuse mais suicidaire, dans une avant-garde qui combat des moulins ou une arrière-garde qui sonne l'olifant » (p.23).
L'héroïsme humble est repris plus intimement, avec humour, à partir d'un vers de Corneille : « 'J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois', je préférerais : 'J'ai fait ce que j'ai pu, je fais ce que je peux'. Moins glorieux, mais davantage dans mes cordes. » (p.71). Ce vers répond mieux à vivre avec la sensation de l'absurde, « sorte de vertige qui prend à certains moments, lorsqu'on se sent étranger à l'environnement, aux autres, à soi. » (p.127). Cette sensation, discutée avec Camus en fin de livre, parcourt les notes. On la trouve dans une description de « l'inhumain » de la mer (p.80) ; lors d'un « examen de minuit » qui porte sur « quoi vivre ? » (« Quand le 'quoi ?' fait retour, c'est généralement des heures douteuses ; du vertige et de la liberté déblaient, ouvrent un vaste espace. » p.13) ; « quand quelque chose », au jardin « devient parfaitement étranger » (p.126) ; lorsque les « ombres illisibles » de la mémoire se présentent « pour rien puisque muettes et presque sans nom. » (p.113).
L'absurde enferme :« Si tout s'équivaut, on est dans le rien et on y reste, passivement. » (p.128). On entend un écho dans une autre note ; cette fois, Shakespeare est détourné : « Beaucoup de vie pour rien. C'est l'entassement de ces riens qui finit par faire une existence. On ne retourne pas à la poussière, on la fabrique avec constance. » (p.77). Mais, avec Antoine Emaz, reconnaître le « rien » crée aussi de la liberté et enjoint à plancher pour « intensément vivre » (p.53). De là, peut-être, l'affirmation de la « confiance dans une communauté de langue. Elle doit porter vivre, approximativement, autant que possible, mieux que rien. » (p.86).
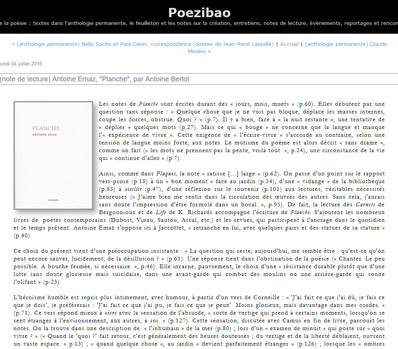
Retrouvez l'article sur Poezibao

« Aller au plus simple. Pas de stuc, pas de dorures », Antoine Emaz
Antoine Emaz le précise dès la première note de ce nouvel ensemble. Chez lui, le poème ne répond plus. Quelque chose l’empêche de venir et il ne sait (ne peut) expliquer ce blocage qui dure et qui pourrait entamer sérieusement sa nécessité de « vivre-écrire » s’il n’y avait, pour pallier ce manque et garder l’équilibre, l’écriture réconfortante et régulière de ses carnets.
« Qu’est-ce que c’est ? Quelle part de ma vie ne passe plus, racle au point que des coupe-circuits soient nécessaires pour me permettre de la supporter ? »
Qu’on ne compte pourtant pas sur lui pour se plaindre. Cela est ainsi. Ça lui pèse mais il fait avec et continue d’avancer sur un chemin qu’il connaît bien, qu’il empruntait d’ailleurs déjà du temps où le poème ne se dérobait pas, celui des carnets. Ceux-ci sont en grande partie rythmés par ses lectures et par les réflexions qu’elles suscitent en lui. Il s’y montre curieux et attentif, plutôt bienveillant, perpétuellement à l’écoute des autres, suivant de près chaque parcours, heureux d’ajuster sa pensée pour la rendre claire et précise.
« J’aime bien me sentir dans la circulation des œuvres des autres. Sans cela, j’aurais sans doute l’impression d’être formolé dans un bocal. »
Ces notes, qui tournent autour de l’axe lecture-écriture, s’ouvrent également à certains aspects du quotidien de l’homme Emaz. Il évoque ainsi, sans jamais s’épancher, le travail qui parfois l’exténue, la fatigue qui s’empare de lui chaque soir, son corps qui tombe malade, mais aussi des moments de brève plénitude, dus à « la densité du silence », ou à quelques « traînées roses dans le bleu passé du ciel », ou encore à un soleil de fin d’après-midi qui ne réussit pas à « chauffer le vent »..
Un livre, tout particulièrement, l’accompagne lors de la rédaction de cet ensemble. C’est le Carnet de notes de Pierre Bergounioux. Il y revient régulièrement. Se montre intrigué, étonné et captivé par le travail de fourmi de celui qui pointe minutieusement tous ses faits et gestes ainsi que les diverses turpitudes de sa vie en parlant à peine de ses travaux et projets littéraires. Emaz extrait çà et là quelques fragments du journal de Bergounioux. Il les analyse, les commente, dit ses accords ou ses réserves. Le suivre ainsi, lisant un autre, sur la durée, est tout simplement passionnant.
« Distance et litote : il est "contrarié", "marri", pas en colère ou énervé. Toujours des faits et une distance prise, comme s’il se voyait à travers sa main d’écrivain. Du coup, il ne livre pas de l’intime brut mais de l’intime décanté. »
Antoine Emaz travaille au plus près de l’instant présent. Qu’il nourrit à sa façon. "En lisant, en écrivant". En prenant, en recyclant, entraîné dans ce mouvement essentiel et très tendu du « vivre-écrire », ce qui lui paraît nécessaire pour tenir en restant perpétuellement en éveil et en alerte.
Retrouvez l'article sur remue.net littérature
Troisième volume de notes publié chez Rehauts1, Planche poursuit l’autre chemin d’écriture d’Antoine Emaz. Plutôt que de parler de voie parallèle à celle des poèmes, j’évoquerais plutôt une route sinueuse qui croise l’autre mais prend ses propres détours, car si la poésie est très présente dans ce volume, il ne se borne pas à elle. Le titre : polysémique, comme presque tous les titres des livres d’Emaz ; planche en tant que substantif : une pièce de bois qui fait sol, mais aussi ce qui permet d’aider ou de prendre appui, selon qu’on tendra la planche ou qu’elle servira d’appel - ; le nom exprime également un lien au travail – celui qu’on a sur la planche, précisément -, on pourra dans ce cas entendre aussi l’impératif du verbe plancher dont le destinataire est autant le lecteur que l’auteur lui-même. Sans poursuivre l’inventaire du champ sémantique de ce mot, on voit que cela tire dans deux directions : la mise à plat à partir d’un élément concret, quitte à ce que celle-ci ouvre un autre espace, et la question du travail.
Cette double entrée parcourt l’ensemble de ce volume, axé sur lire / écrire ; certes, on y retrouve des éléments de la vie quotidienne – présence discrète de la famille, d’un plat à cuisiner, du boulot de prof (« ma fatigue à aller devoir faire cours alors qu’enseigner est un beau métier » p. 28), par exemple – ou des lieux auxquels elle est associée – Angers pour le temps scolaire, Pornichet pour celui des vacances (« L’air d’Angers, je le respire ; l’air d’ici, je l’avale » p. 15) -, mais globalement ce qui domine est à la fois une attention au travail des autres et une réflexion sur sa propre pratique, les deux se nourrissant mutuellement, j’y reviendrai. Un mot sur la composition du livre : puisqu’il n’est pas daté, ce n’est pas un journal, et cependant on peut y trouver des éléments qui s’en rapprochent ; Emaz creuse à plusieurs reprises cette distinction, par exemple à l’occasion d’une proposition d’entretien que lui fait Florence Trocmé : « la note me semble plus libre, souple, alors que le journal est une forme assez codifiée » (p. 62) ; s’appuyant sur la lecture laborieuse des Carnet de notes 3 de Bergougnioux, il stigmatise dans le journal la présence du « détail » et du « répétitif » (p. 63, et p. 123 pour le « ressassement », « effet mécanique d’une écriture immédiate, quotidienne »). A propos de la datation : « Pas besoin de dater les notes ; les livres, le jardin suffisent grosso modo pour connaître l’année, saison… » (p. 100). Néanmoins, on peut se demander si l’agencement des notes dans Planche obéit à un ordre strictement chronologique ou savamment construit, car les thématiques des notes sont distribuées dans une sorte de cycle, leur enchaînement ne semble pas aussi fortuit que si elles avaient été choisies et posées les unes après les autres telles qu’elles apparaissent dans la suite des carnets. S’il y a chronologie (la lecture longue et lente de Bergougnioux et de Keith Richards accompagne la seconde moitié du livre), elle est peut-être arrangée ici et là par l’emplacement de notes dont la datation n’a au fond pas d’importance. L’incipit et l’excipit semblent trop symboliques pour être le fruit d’un hasard : « Certains disjoncteurs sont coupés. Pourquoi ? Par qui ? Cela ne chamboule pas ma vie, elle continue d’aller », cette note liminaire se poursuit avec « un blocage, dedans » (p. 7) ; « Erre : mot que j’aime bien. Echos avec air, errer (…) Erres : titre pour un recueil de notes ? » (p. 129). Mais qu’il y ait ou non arrangement a-t-il de l’importance ? C’est le propre du recueil que de pouvoir s’organiser librement : l’orientation davantage marquée dans ce volume autour de lire / écrire provient d’un choix de notes puisées dans les carnets, non du caractère discutablement aléatoire d’un travail autobiographique.
Impossible de retracer la richesse des thèmes abordés par Antoine Emaz dans ce puzzle sans modèle. S’il se défend d’une pensée qui viserait à une unité, je ne peux m’empêcher de lire en arrière-plan une dimension morale : « Même quand j’écris ce qui peut prendre des allures de vérité générale, je ne me sens pas dans l’éternité des moralistes classiques » (p. 100). Avec le temps, certaines éternités deviennent relatives. Se construisent en creux une image du monde (un monde « sale » - pp. 39, 47, 56 par exemple, « la glu du réel » p. 22 – jugements qui peuvent ouvrir sur une considération politique lorsqu’ils sont associés à l’espace social) et un regard sur ce monde dont le relativisme et le pessimisme résignés valent lucidité : « Il y a des moments de vie où le temps rattrape, prend au collet, étrangle. Dans le même instant, on voit ce qu’on a misérablement gagné, et puis tout ce qu’on a perdu. (…) Au mieux, dans ces moments, on devient sage ; au pire, on devient méchant » (p. 21). « Si, au bout de soi, on découvre qu’il n’y a rien, on est allé au bout de rien, et c’est déjà quelque chose » (p. 106). Ce regard sur une vie débarrassée de la promesse pascalienne de Dieu se concentre sur ce qui est de l’ordre du tangible : en font partie la lecture et l’écriture, comme de simples moments de vie qui la concentrent en nous permettant de nous détacher et / ou d’affronter nos obstacles internes ; en fait aussi partie le végétal, dont le jardin2 demeure l’épicentre, ouvrant parfois sur un ciel qui accroche les mots parce que sa couleur « n’existe pas dans le nuancier mental » (p. 91) : éléments qui deviennent stables par opposition à une vie d’homme que le temps use, dans son corps et dans sa conscience. Usure que l’impression de vieillir3 amplifie, accrue par les hasards de l’existence, c’est-à-dire par ce dont la responsabilité vous échappe mais qui vous contraint : « une vie n’est que très peu guidée par le rationnel ou bien ce n’est pas une vie » (p. 84). Encore un peu tôt pour le classicisme, pas pour le moraliste.
Revenons-en à lire / écrire. La lecture s’articule autour de deux pôles : celle des contemporains, exclusivement de la poésie, à l’exception de Bergougnioux et Richards ; en une page ou une demie page, Emaz rend compte d’un livre de poésie avec une concision et une économie de moyens qui lui permettent de mettre l’essentiel en évidence : intérêt thématique ou formel d’un livre, place dans l’œuvre, importance de ce livre ou de cette œuvre. Plus de trente poètes contemporains sont présents. Si Bonnefoy et Jaccottet reviennent à plusieurs reprises, ce n’est pas en raison de leur âge, c’est le hasard des lectures : l’admiration pour leur travail est d’ailleurs relativisée, mais elle rejoint le cercle de bienveillance dans lequel Emaz inscrit l’ensemble de ces notes, de James Sacré ou Franck Venaille à Albane Gellé ou Stéphanie Ferrat. Cette bienveillance sans mollesse se double d’un regard ironique sur le milieu de la poésie d’aujourd’hui, « tout un petit monde qui vibrionne, dont le centre est partout et la circonférence nulle part » (p. 76). A côté du contemporain, des phares de la littérature, à l’occasion de relectures ou des hasards de la mémoire : si Montesquieu est présent, on y trouve surtout 17, 19 et 20èmes siècles. Racine et Corneille servent de pivot à une réflexion morale, Balzac à une considération littéraire, alors que les citations de Rimbaud émaillent ici une description, là un propos d’histoire littéraire en amont de Dada (p. 31) ; ainsi de Reverdy, Camus ou Max Jacob. Evocation des lectures à l’adolescence - les policiers puis les grands romanciers français ou étrangers, de Proust à Dostoïevski – qui permet de mettre en perspective la manière dont la poésie est peu à peu devenue exclusive dans la « boulimie de lectures » : « L’horizon s’est comme rétréci, alors qu’en poésie il est resté ouvert et même s’élargit encore » (p. 26).
Les lectures innervent la réflexion sur l’écriture, celle des carnets, comme je l’ai évoqué avec la distinction du journal, mais surtout celles des poèmes. Plusieurs notes se réfèrent à des livres d’Emaz auxquels il travaille ou qui sont publiés : Plaie4 qui est en phase de lissage, et d’autres textes moins visibles, petites éditions ou livres d’artistes, qui sont le prétexte à réfléchir sur le poème et la publication, sa capacité à poser le texte ainsi que la présence en miroir du travail des artistes : la description du travail « minimal et percutant » de Pierre Emptaz dans Bout de souffle5 rejoint la pratique d’écriture émazienne : « « L’idée de travailler en moins ; non pas ajouter, mais enlever ; cela aussi m’est très proche » (p. 57). De façon plus générale, ce qui touche à la matière du poème est constamment présent ; par exemple, la force initiale du poème : « Ce qui me manque, c’est une entame, un angle d’attaque, une force propulsive initiale » (p. 14) ; « Tout ce travail interne, terriblement lent. A la fois parce que je n’ai pas de facilité et parce qu’une sorte de maturation est nécessaire pour que tombe ce qui doit tomber. Ma force, c’est la masse : je peux toujours maigrir. Mon problème, c’est la masse, quand rien ne se constitue assez » (p. 124). Ainsi également de la place du je comme source d’écriture et comme facteur d’énonciation : « Sauf quand on écrit, on n’a jamais besoin de tout ce qu’on est. Est-ce pour cela qu’on écrit ? Pour se sentir (un peu) entier ? » (p. 82). Les questions formelles, le rapport entre vers et prose, la fabrication du poème, la place du lecteur, la primauté de la justesse (« une évidence sonore immédiate » p. 128), cette matière est examinée dans son processus autant que dans sa finalité : « Il y a peu de plaisir à ‘peaufiner un texte’. Ce qui domine, c’est l’irritation de l’inexact. » (p. 112). Sinon pour affirmer le postulat de la poésie (« La poésie n’est ni issue ni impasse, elle est » écrit-il de façon péremptoire p. 22), l’attention à sa propre manière, toujours fondée sur des images concrètes ou mécaniques (on ne s’étonnera pas de la fascination d’Emaz pour les chantiers, p. 10), n’est jamais orientée vers une sorte de discours docte ou définitif. Elle se prête ou se donne comme une expérience relative, non définitive, ne cherchant ni l’exemplarité ni les sommets - ce qui est sans doute un meilleur moyen de pouvoir les atteindre. Au contraire, en tant que planche, elle sert d’appui à qui souhaiterait réfléchir à la pratique d’un poète majeur de notre époque et à sa propre pratique. « Toujours aller vers soi-même, mais pas égoïstement ou narcissiquement ; simplement parce que c’est le plus direct chemin pour aller vers sa part profonde d’humanité. C’est par elle que l’on peut vraiment rejoindre les autres » (p. 17). Livre tout simplement généreux.

Retrouvez l'article sur Poezibao

On ne parle pas beaucoup des revues, ici ou ailleurs, alors qu’elles accueillent les premiers textes d’écrivains, souvent aussi les premières traductions d’auteurs étrangers. Pour cette raison il faut les défendre ; et d’autant plus vigoureusement que beaucoup de bibliothèques se désabonnent, prétextant "la crise", comme si une dizaine d’abonnements à des revues de référence pouvaient grever un budget. Bien des revues disparaissent (Recueil en 2008, Siècle 21 en 2010, L’Arsenal en 2011, parmi d’autres), une bonne partie de celles qui résistent vit difficilement. Donc, oui, il faut défendre, c’est-à-dire lire les revues littéraires, de poésie, et demander à la bibliothèque que l’on fréquente de s’abonner*.
La revue Rehauts est née en 1998 et son sommaire reste passionnant, d’un numéro à l’autre, deux fois par an. Chaque livraison s’ouvre sur une traduction, cette fois d’un poète mexicain, José Carlos Beccera, encore peu connu en français (dans le n° 35 Maïtreyi et Nicolas Pesquès présentaient pour la première fois une poète américaine, Carol Snow). Ensuite, ce sont des poètes et des prosateurs plus ou moins familiers aux lecteurs : je retrouve Ludovic Degroote, Gilles Ortlieb, Hélène Sanguinetti, Sophie Loizeau, Jean-Pierre Chambon, et je les retrouve avec ce plaisir que l’on a d’être en terrain familier. Je connaissais les travaux de Joël Cornuault sur Élisée Reclus et ses traductions de Keneth Rexroth et John Burrougs, je découvre le poète ; je n’avais jamais lu Isabelle Zribi (personne n’est parfait) et les extraits d’un travail en cours, Arnaud le trou ou l’invention de la fiction, déjantés et pleins d’humour, me font noter le titre de son dernier roman. Restent encore à lire de courtes proses de Mathieu Nuss, comme celle-ci :
Rien de moins docile que le ventre vide d’une porte-fenêtre. Qu’un rideau qui bat tout contre. Les blancs que laissent les écailles de peinture dessinent une mâchoire de mastodonte..
Aussi un long poème de Jean-Pierre Chevais dont le personnage et le jeu des répétitions m’évoquent l’univers de Kafka ; les dessins et poèmes de Ricardo Mosner ; le travail sur des photographies de Tony Soulié. Sept poèmes enfin de Julien Bosc, qui précèdent les notes de lecture ; c’est par eux que j’ai commencé — on ne lit pas une revue en suivant le sommaire— à cause du nom, bosc (comme bos) désignant un bois, une forêt en limousin (j’ai failli commencer par Loizeau). Ce sont des poèmes qui, presque tous, sont construits comme des listes : le compte des petites choses de la vie, et la mélancolie quand on pense parfois à ce que l’on fait de ses jours.
à vingt jours du printemps
offrir un nouvel ait à la terre du jardin en
ratissant les feuilles mortes puis
allumer un feu de petits bois et vieux genêts
les y jeter et voir partir en fumée
penser qu’on pourrait se pendre
aller savoir pourquoi à ce moment-là
[...]
Me voilà moins ignorant : outre le plaisir de sa lecture, la revue me conduit ailleurs ; je lirai le dernier roman d’Isabelle Zribi, les recueils de Joël Cornuault et de Julien Bosc. C’est là à mes yeux la fonction principale et irremplaçable d’une revue : ouvrir l’horizon toujours un peu étroit du lecteur.
Retrouvez l'article sur sitaudis.fr
(Lettres Françaises n° 131, novembre 2015, page VII, en haut de page « Chronique de poésie » de Françoise Hàn)
Le 25e salon de la revue, qui s’est tenu à Paris les 10 et 11 octobre, regroupait un peu plus de 200 exposants de toutes catégories – revues, maisons d’édition, portails, diffuseurs, associations –, dans des disciplines diverses. Les revues dédiées à la poésie ou publiant régulièrement des poèmes ont toujours, dans ce salon, une présence non négligeable, les grandes absentes étant, comme les années passées, la NrF et Po&sie. Parmi les exposants fidèles, on retrouvait Europe, mensuel de littérature générale, et Rehauts, semestriel d’art et de littérature.
Europe, numéro d’octobre : le romancier, prix Nobel 2014, Patrick Modiano, est en photo de couverture. Le dossier important qui lui est consacré est présenté par Maxime Decout. Un second dossier concerne Eugène Savitzkaya, né en 1955, auteur de récits, de romans à l’imaginaire débridé et aussi de poèmes, ou bien ses romans sont aussi des poèmes. C’est un oiseau rare, selon Thierry Romagné qui le présente et rapporte les propos tenus lors d’un entretien avec lui, sous le titre « Les livres sont des lieux où tout arrive ». Jean-Baptiste Para, en quelques notes, pénètre subtilement l’écriture de Savitzkaya. On pourrait parler, dit-il, de « prose de poète ».
Le Cahier de création propose une nouvelle d’Angelika Klüssendorf traduite de l’allemand par Virginie Mourany, des poèmes en prose de Pablo Montoya, traduits de l’espagnol (Colombie) par Christophe Barnabé, qui donne à la suite les Notes indiscrètes de Pablo Montoya. Puis, viennent des poèmes de Jaroslav Mikolajewski, traduits du polonais par Agata Kozak, et de Paolo Ruffilli, traduits de l’italien par Patrice Dyverval Angelini.
Dans les chroniques, Philippe Beck rend compte de la Vie comme au théâtre, de Florence Delay ; Jacques Lèbre, de l’élargissement du poème de Jean-Christophe Bailly, les 4 Vents de la poésie, de l’Anthologie de la poésie chinoise parue en « Pléiade ».
Rehauts, automne-hiver 2015 : riche en contributions remarquables, la livraison s’ouvre sur quelques extraits de Comment retarder l’apparition des fourmis, de José Carlos Becerra. L’œuvre de ce poète mexicain, décédé accidentellement en 1970, à trente-quatre ans, est d’une force singulière. Octavio Paz la soutenait et l’a préfacée. Ses deux traducteurs, Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo, ont déjà fait paraître Récit des événements (Belin, 2002) et La Venta,précédé de Parole obscure(La Nerthe, 2014). Citons ensuite Mathieu Nuss: « Langue, quand ses mots ne seront plus que des clics et tacs » (Crochets X) et Ludovic Degroote : « Réduire la distance / qui vous mène à vous-même / à travers ce qui disparaît » (Ensemble). Gilles Ortlieb fait le récit d’un voyage dans une île grecque. Sans titre (c’est le titre), de Jean-Pierre Chevais, donne une allégorie, à base de sandwichs et de pauses dans une tâche indéterminée, de la condition humaine. Le texte d’Hélène Sanguinetti joue de signes typographiques pour mener de l’une à l’autre ses notations. Jean-Pierre Chambon, en pages alternées de tercets et de quatrains, sinue Sur l’étang. Isabelle Zribi évoque une enfance réduite au silence par une vieille institutrice revêche.
Côté graphique, Tony Soulié produit avec des techniques mixtes sur photo des effets intéressants. Ricardo Mosner commente ses dessins par ses propres poèmes placés en vis-à-vis. Le numéro se termine par des notes de lecture de Jacques Lèbre et Joseph J. Guglielmi.

Retrouvez l'article dans Les lettres françaises
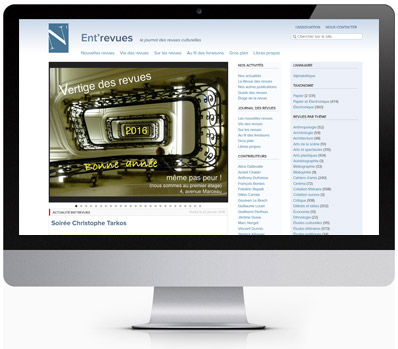
Légèrement décentré, le titre, caractère bâton affirmé, bleu tendre sur un gris pâle: fraîcheur. Rehauts s’offre une légère mue de printemps, réaffirmant la sobre et constante élégance de la revue d’Hélène Durdilly. Dans le sommaire de ce numéro 35 se recompose une partie de la communauté d’écrivains que la revue aime à suivre (Étienne Faure, Daniel Cabanis, Sereine Berlottier…). Ou encore cet autre « pensionnaire » de Rehauts, Philippe Boutibonnes qui donne une longue analyse des dessins – visages pour l’essentiel dont quelques-uns ici reproduits – de Sarah Kofmann. Autres femmes remarquables : avec, de montagne et de roche, les poèmes crénelés de Fabienne Raphoz ; Cécile Mainardi pour une série de poèmes réjouissants en forme d’œuf : « Des poèmes à la coque » ; ou encore en ouverture du numéro l’américaine Carol Snow pour des poèmes que la peinture (Cézanne, Matisse, Bacon) conjugue. Art partout dans Rehauts : au cœur de la livraison, la superbe série de dessins de Claude Hassan, dont le trait lourd mais sensible, essentiel fait surgir des formes (figures, objets ?) comme en instance d’incarnation ou comme reliques de leur passages…
Dernière femme pour un long et magnifique poème : « Mère/ demain/ tu meurs/ Quarante ans/et tu recommences déjà/ Cœur s’arrête tous les quinze janvier ». Jean-Louis Giovannoni à sa mère morte le 15 janvier 1974. «Ta main – où est ta main»
Retrouvez l'article sur entrevues.org
(Le Matricule des Anges, n°163,mars 2015)
Sobre, discrète, mais endurante, la revue Rehauts propose, pour attaquer le mois de mai et passer vers les foins de juin, de suivre l'affirmatif "For" de Carole Snow, "Pour" ne serait-ce qu'accueillir ce que d'autres excluent. Poèmes méditatifs mystérieux et comme flashés de lentes réminiscences, poème-film de micro-récits, "Pour" se penche sur Cézanne ("cette posture// précaire de la danse"), Bacon (les visages se tournent aussi loin que possible à jardin (à l'égyptienne)", Le Bernin, et de ces trois superpositions évoque "ce visage détourné" où se dirait "non pas la scène d'un acquiescement croissant - où le juste milieu serait bizarre - mais d'une volonté décroissante, et finalement érotique".
Jean-Louis Giovannoni revient, lui, sur la mort de la mère (après le fameux garder le mort), fragments secs, oeuvrant à l'exposition d'un infigurable, tel ce "Draps solides// et toi/ immobile/ nerfs coupés// Sur la photo/ route et arbres/ se tiennent au bord". Philippe Boutibonnes poursuit la voie ouverte par la question de la figuration : se penchant sur les dessins de la philosophe Sarah Kofman, il note qu'elle "figure ainsi plus qu'elle ne représente le visage de qui n'a pas de visage ; le sien, infaillible, infiltre chacun de ceux qu'elle dessine", une figure hors de portée. Les "Poèmes à la coque" de Cécile Mainardi disent d'autres châteaux hantés, pas seulement par l'enfance, mais par l'agilité enfantine avec laquelle elle offre des sensations ultrarapides, comme celle-ci "(...) ne/ ige toute fraîche à peine tom/bée devant la maison je film/ e son délice impressionniste, son éloqu/ ence muette, son grabuge blanc, je pense/ à Degas comme étant le mieux/ placé non pour le peindre/ mais pour s'en délecter/ sans limite et sans (...)".

Retrouvez Le matricule des anges